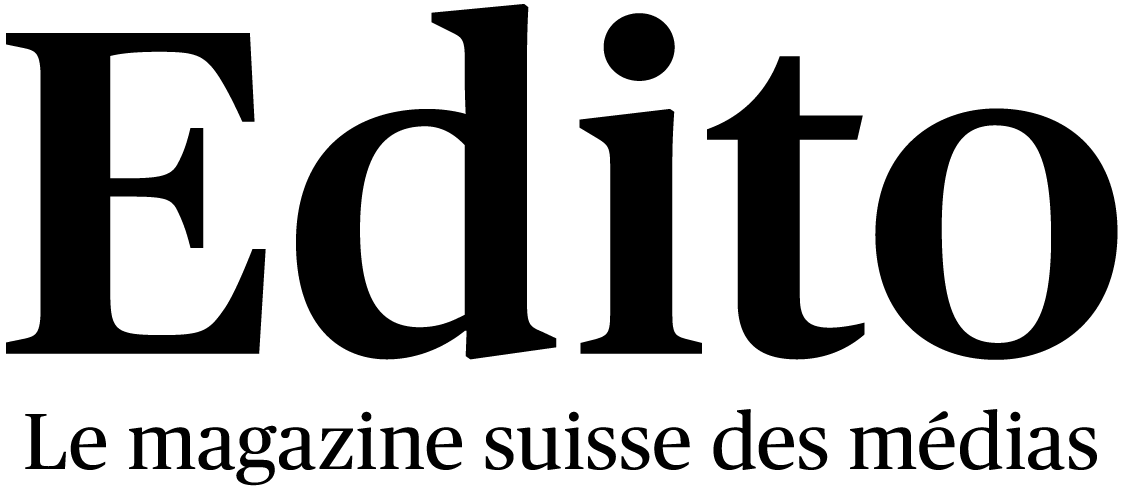La redevance a été étendue à tous les ménages pour des raisons techniques. Le débat sur le rôle des médias publics aura lieu en 2016. Eléments de réflexion.
Par Alain Maillard
Qu’il y ait besoin d’un service public en Suisse, personne ou presque ne le conteste. Surtout par souci d’assurer «la cohésion nationale», argument fréquemment invoqué sans être très étayé. Près de sept heures de débat au Conseil national, le 12 mars, sur la généralisation de la redevance à tous les ménages, ont clairement illustré ce soutien de principe. En ce mois de juin, c’est au tour des Etats. Seule fait débat l’ampleur du service public. Doit-il inclure du divertissement? Des sports coûteux? Faudrait-il le repenser, voire l’élargir, quand internet modifie la consommation de l’audio-visuel?
Redéfinir le service public: une minorité du Conseil national aurait bien voulu le faire ce jour-là. «Ce changement de la perception de la redevance est l’occasion idéale de redéfinir ce qu’est le service public», a plaidé par exemple l’UDC zurichois Max Binder. La majorité n’a pas voulu de ce débat préalable. Mais ce n’est pas par refus de fond: la discussion aura bientôt lieu de toute façon. Un postulat de Filippo Leutenegger, ancien cadre de la télévision alémanique, demande un réexamen des prestations de la SSR. Il a été accepté par le Conseil fédéral, qui remettra un rapport aux Chambres.
Dans son développement, le fondateur et ex-animateur de l’émission politique Arena précise: «La convergence des systèmes médias (presse, radio, TV, Internet) est source de nouveaux conflits entre les diffuseurs subventionnés par voie de redevances, en particulier la SSR, et les diffuseurs qui dépendent de financements privés. (…) Le Conseil fédéral doit montrer, pour tous les domaines du secteur public (information, politique, culture, sport) et pour toutes les régions linguistiques, quelles offres de radio/TV financées publiquement doivent l’être par la taxe sur les ménages et lesquelles peuvent être laissées au libre jeu d’un marché des médias fonctionnel sans qu’il en résulte de distorsions du marché.»
Comme ce texte le montre bien, le débat est à la fois ancien et renouvelé. Depuis toujours, des voix critiquent le poids de la Société suisse de radiodiffusion, son quasi-monopole audio-visuel et le coût de la redevance, une des plus élevées du monde (ce que relativise la SSR en demandant qu’on tienne compte de la diffusion en quatre langues et de l’étroitesse du marché). D’autres mettent en cause son «politiquement correct», sa «pensée unique», jugeant que sa manière de présenter les informations n’est pas impartiale – même si les temps d’antenne des partis sont soigneusement équilibrés, ce que personne ne conteste.
Mais ce qui justifie la généralisation de la redevance – tout le monde est connecté, tout le monde peut consommer des émissions sur son ordinateur ou son téléphone portable – ne justifie-t-il pas tout autant de se redemander ce qui, désormais, définit la place du service public? Pourquoi seulement le son et l’image? Pourquoi devrait-il encore nous divertir quand nous sommes submergés de divertissements?
N’en déplaise à ses détracteurs, le public suisse est largement acquis à ses chaînes publiques. La RTS atteint près de 60 % de parts de marché (pdm) et 35 % en télévision. La popularité consensuelle d’un Darius Rochebin, inamovible présentateur du téléjournal et star des pages people, en est une autre illustration. Simple force des habitudes? C’est difficile à évaluer, même si le vieillissement du public (voir Edito 2/14) semble l’attester. Avantages d’une situation acquise, qu’on voudrait préserver parce qu’on voit bien que ça marche? Est-il fondé de craindre une «atomisation des médias», comme le dit Gilles Marchand, directeur de la Radio télévision suisse? Au détriment du débat public et de la démocratie ? Les concessions accordées par l’OFCOM donnent un avantage considérable au service public. Est-ce nécessaire? Pourquoi la Suisse si libérale garantit-elle une position très avantageuse au service public audiovisuel, plus que la plupart des pays démocratiques?
Pour répondre à ces questions, il faudrait clarifier ce qu’on attend du service public. Que disent les textes légaux? On a beau chercher, on n’y trouve pas de définition. On y trouve des arguments consensuels en faveur d’un audio-visuel public: la cohésion nationale, la diversité culturelle, les besoins de la démocratie directe. Mais aucun texte juridique n’explique en quoi il est nécessaire qu’une institution financée par un prélèvement obligatoire assure ces services. La Constitution fédérale assigne une mission à la radio et la télévision (article 93) sans même préciser si celles-ci doivent être publiques. «Elles contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l’opinion et au divertissement.» Puis : «Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.»
La Loi sur la radio et la télévision se contente de préciser (art. 23) que «la SSR fournit un service d’utilité publique». Faut-il considérer que l’article suivant définit cette «utilité publique»? Selon l’article 24 (et la concession qui reprend ces alinéas tels quels), la SSR doit «promouvoir la compréhension, la cohésion et l’échange entre les différentes parties du pays, les communautés linguistiques, les cultures et les groupes sociaux»; elle doit «resserrer les liens qui unissent les Suisses de l’étranger à la Suisse, promouvoir le rayonnement de la Suisse à l’étranger et y favoriser la compréhension pour ses intérêts»; elle contribue «à la libre formation de l’opinion en présentant une information complète, diversifiée et fidèle, en particulier sur les réalités politiques, économiques et sociales», «au renforcement des valeurs culturelles du pays ainsi qu’à la promotion de la création culturelle suisse», «à la formation du public, notamment grâce à la diffusion régulière d’émissions éducatives», et aussi «au divertissement.»
Pourquoi tant de missions? En particulier, pourquoi le divertissement? On peut comprendre qu’il ait fait partie du mandat quand l’audio-visuel public en avait seul les moyens. Mais aujourd’hui? La SSR l’invoque surtout comme un besoin pour conserver une large audience: les chaînes publiques ne garderont pas une place prépondérante si elles ne fournissent aux auditeurs et téléspectateurs que de l’information ou du culturel. A l’appui de cette position, on peut pointer la marginalisation des chaînes publiques dans d’autres pays. Mais c’est un argument pragmatique, qui n’a plus grand chose à voir avec une mission de service public de divertir les habitants de ce pays. Le débat, ici, est un peu faussé.
C’est bien la part du divertissement que vise surtout le programme de l’UDC, dans lequel on peut lire que le parti «s’engage pour une définition claire et restrictive de cette notion (de service public). Pour l’assurer, il n’est pas nécessaire d’entretenir une grosse entreprise de droit public qui encaisse 1,2 milliard de francs par an de redevances pour ses vingt chaînes de radio et de télévision.» Dans un rapport sur «Les limites du service public» (2007), le théoricien libéral Jan Krepelka va jusqu’à lui contester tout fondement. De deux choses l’une, argumente-t-il: soit le service public correspond aux attentes du public, et le public en payerait volontairement le coût, soit il n’y correspond pas, et il ne devrait pas exister. Comment le justifier si ce n’est par les attentes du public? Donc, «financer l’audiovisuel par la contrainte étatique est soit inutile, soit injustifié.»
Argument massue qui pourrait aussi justifier la renonciation aux impôts… mais le public payerait-il volontairement des contributions pour obtenir des prestations publiques? A contrario, c’est la justification de la redevance: elle assure que tout le monde contribue à un audio-visuel public disposant ainsi des moyens d’assurer des prestations au moins satisfaisantes. Et dont tout le monde peut bénéficier: «Dans le secteur public, disait la conseillère fédérale Doris Leuthard devant le Conseil national, le 12 mars, on met à disposition de la population des prestations, qu’elle les consomme ou pas.»
Qu’elle les consomme ou pas: ce serait donc accepter le risque d’une perte de prépondérance. Or tout est fait, dans la loi et l’attribution des concessions, pour éviter ce risque. Comme si un compromis historique à demi-formulé sous-tendait le débat: au privé la presse, au public l’audio-visuel. Et quand le compromis est bousculé par l’émergence du numérique, où cette distinction s’estompe, on en profiterait pour rééquilibrer un peu la répartition entre le privé et le public, devenu quand même un peu trop puissant, en limitant ce que peut y publier la SSR.
Il reste un argument essentiel, moins ancré dans les textes mais plus en vogue depuis que la concurrence privée est en mesure d’offrir des contenus comparables dans l’audio-visuel: celui de la qualité. C’est le premier qu’invoque le Conseil fédéral quand il se risque, en 2004, à une définition du service public dans un rapport répondant à une intervention parlementaire: «Par service public, on entend des services de base de qualité, définis selon des critères politiques, comprenant certains biens et prestations d’infrastructure, accessibles à toutes les catégories de la population et offerts dans toutes les régions du pays à des prix abordables et selon les mêmes principes.»
A lire cette définition, on peut se demander pourquoi la SSR en bénéficie et pas l’ATS, pourvoyeuses de dépêches qui pourraient être qualifiées de «prestations de base de qualité» en matière d’information nationale. Mais en quoi le service public donne-t-il de meilleurs garanties de qualité? Parce qu’il ne vise pas le profit? Et qu’il dispose d’un certain confort financier? Peut-être. Mais des chaînes de pays voisins et méridionaux pourraient être citées en contre-exemples. Et comment mesurer la qualité? Le public, qui peut donner son avis par le canal des SRT cantonales, se montre généralement satisfait. Est-ce un critère suffisant? Quels sont ces «critères politiques» qui selon le gouvernement définiraient la qualité? On comprend: ceux que fixe le parlement. Qui, à notre connaissance, ne l’a jamais fait en ce qui concerne l’audiovisuel, si ce n’est dans l’invocation – toujours – des arguments politiques comme la cohésion nationale, la diversité culturelle, une information équilibrée.
Le débat sur le service public vaut la peine d’être mené: c’est aussi un débat sur le rôle des médias.
Votre commentaire